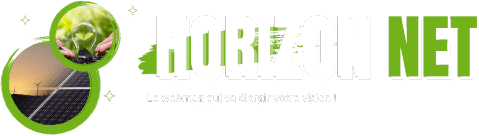Comment rendre les bâtiments collectifs inclusifs et adaptés à la vie quotidienne
Les urbanistes et les architectes sont de plus en plus confrontés au défi de concevoir des projets d’habitat qui fonctionnent réellement pour tous – des familles avec poussette aux personnes âgées, en passant par les personnes en situation de handicap. Pour y parvenir, il faut des concepts de construction inclusifs, qui envisagent le bâtiment à partir de l’usager et de son quotidien.
Miser sur la participation plutôt que de simplement respecter les normes
L’accessibilité est réglementée par la loi, mais l’inclusion véritable commence dès la phase de planification. Un accès de plain-pied est obligatoire, mais reste insuffisant à lui seul. Des études, comme celle de l’Université d’Aalborg, montrent que les bâtiments dotés d’aides à l’orientation sonore, de systèmes de guidage visuel et de marquages au sol contrastés augmentent jusqu’à 40 % l’autonomie des personnes ayant une déficience visuelle ou des troubles de la mobilité. La structure du cheminement dans le bâtiment joue également un rôle essentiel: plus elle est claire, plus l’orientation est facilitée – un avantage précieux pour les personnes atteintes de troubles cognitifs ou de démence.
À retenir : Une architecture inclusive ne pense pas seulement à l’accès, mais au quotidien.
Des espaces communs réellement utilisés
Un local commun vide est un espace perdu. Pour qu’il devienne le cœur social du bâtiment, il doit être modulable et accueillant. Une étude menée par la ville de Vienne a révélé que les pièces multifonctionnelles avec mobilier flexible (par ex. chaises empilables, cloisons mobiles) sont utilisées 25 % plus fréquemment que les espaces figés. Les aménagements les plus recherchés sont :
- des cuisines ouvertes pour cuisiner ensemble
- des pièces avec isolation phonique pour la musique ou les ateliers
- des coins calmes avec un bon éclairage pour lire ou se détendre
- des espaces de change et des sanitaires accessibles
Ce n’est pas la superficie qui compte, mais une planification intelligente et un accès sans barrières.
Des systèmes numériques pour renforcer l’inclusion
Le numérique peut prévenir l’exclusion – s’il est intégré dès la conception. Dans de nombreux projets récents, on installe aujourd’hui des systèmes de réservation digitaux pour les espaces communs, les boîtes à colis ou les véhicules partagés. Les prestataires de services en bénéficient aussi : un logiciel pour coiffeur montre comment organiser efficacement les rendez-vous et adapter l’offre aux structures du bâtiment, par exemple pour des prestations mobiles dans des résidences collectives ou des logements accompagnés.
Ces outils digitaux offrent un confort appréciable, tout en favorisant l’autonomie : les résidents réservent eux-mêmes, coordonnent les services et échangent entre eux – ce qui réduit les obstacles, même en cas de mobilité réduite.
Le smart living comme soutien discret
Les technologies intelligentes comme l’éclairage à détection de mouvement, les volets roulants automatiques ou la régulation de température via une application ou la commande vocale améliorent le quotidien – surtout pour les personnes ayant des troubles moteurs. Dans un projet pilote belge regroupant 200 logements, des systèmes d’alerte par capteurs (par ex. en cas de fuite d’eau ou de mouvement inhabituel) ont permis d’éviter environ 15 000 € de coûts supplémentaires par an.
Dans les bâtiments collectifs, on mise de plus en plus sur des dispositifs de sécurité discrets et intégrés. Et dans les habitats intergénérationnels, une chose est claire : plus la technologie est intuitive, plus elle est acceptée.